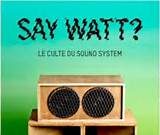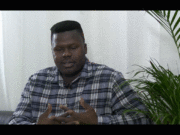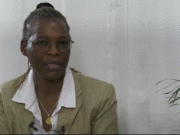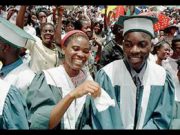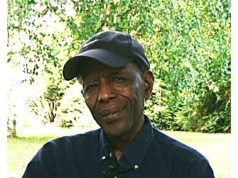Les premières critiques que j’ai découvertes du chroniqueur littéraire ivoirien Zacharie, remontent à six ans, si je ne m’abuse. A l’époque, il démontait avec le style qui caractérise sa prise de parole, le roman Black Bazar d’Alain Mabanckou. On sortait des critiques négatives dites à mi-mots, à voix basse. Le mot sincérité au coeur de son propos va revenir régulièrement dans mon analyse et vous comprendrez pourquoi au fil des ligne. Pour être sincère, en lisant sa recension, j’ai pensé qu’il profitait de l’aura de cet auteur congolais, pour faire le buzz en refusant de céder à une complaisance supposée… Cette critique est d’ailleurs présente dans l’ouvrage qui fait aujourd’hui l’objet de mon commentaire…
Les premières critiques que j’ai découvertes du chroniqueur littéraire ivoirien Zacharie, remontent à six ans, si je ne m’abuse. A l’époque, il démontait avec le style qui caractérise sa prise de parole, le roman Black Bazar d’Alain Mabanckou. On sortait des critiques négatives dites à mi-mots, à voix basse. Le mot sincérité au coeur de son propos va revenir régulièrement dans mon analyse et vous comprendrez pourquoi au fil des ligne. Pour être sincère, en lisant sa recension, j’ai pensé qu’il profitait de l’aura de cet auteur congolais, pour faire le buzz en refusant de céder à une complaisance supposée… Cette critique est d’ailleurs présente dans l’ouvrage qui fait aujourd’hui l’objet de mon commentaire…A l’image de sa méthode de communication, Zacharie Acafou a choisi un titre musclé pour son essai sur la littérature africaine d’expression française. Est-elle un cadavre à la renverse? Que signifie cette expression utilisée par Jean-Paul Sartre à l’endroit de la gauche française ou encore récemment par Bernard Henri-Levy? Il y a là un jeu de référence intéressant mais extrêmement délicat. En effet, la lecture de l’essai se trouve orientée et abordée sous l’angle de ce prisme. Le cadavre à la renverse, on va le chercher. Et la réussite de l’essai dépendra principalement de la réponse qu’apportera Acafou à cette question.
La première phase de son essai est une présentation de la littérature africaine écrite. L’essayiste y présente un historique des grands mouvements des lettres africaines, allant chercher ses premières sources dans les slaves narratives. Le portrait proposé est assez complet et couvre à peu près tous les âges de cette jeune littérature. Il exprime une posture un peu plus critique en définissant la littérature africaine comme un extrême-occident. La notion de périphérie est récurrente quand on parle de littérature africaine ou francophone vis-à-vis de la littérature française, les schèmes néocoloniaux se poursuivent inlassablement. Suffisent-ils à définir cette littérature africaine comme un grand cadavre à la renverse où les vers se sont mis? Sous la plume de Zacharie Acafou, on s’attend à l’autopsie d’un cadavre et au sortir de sa présentation, son analyse nous est plutôt chargée d’espérance.
Connaissant quelques unes de ses chroniques, car ayant fréquenté régulièrement son blog, j’aurais pu faire l’impasse et éviter de lire les 58 recensions extraites pour l’essentiel de son site internet qu’il propose dans la seconde phase de son ouvrage. Mais, je dois dire que j’ai lu cette série d’articles avec le plaisir de découvrir de nouveaux textes mais également en pointant du doigt des tics, des récurrences dans le propos de Zacharie Acafou qu’il aurait beaucoup gagné à analyser et qui forgent, à mon avis, sur la singularité de son regard de lecteur.
Le terrain de la publication
Lors de l’Université Populaire de la Littérature Africaine où il était question de faire un état des lieux de la critique littéraire africaine, je signalais l’intérêt personnel que j’avais à lire les chroniques de Zacharie : il est une vitrine significative d’auteurs publiés sur le continent Africain et qui ont souvent encore moins de visibilité que les auteurs dont les éditeurs sont parisiens. Le point fort dans la production d’Acafou réside dans le spectre très large, traitant avec la même subjectivité un auteur attirant sur lui la focale des objectifs parisiens ou celle/celui qui fait la rentrée littéraire de Bamako. Il y a là une ouverture d’esprit et une résistance au diktat parisien de l’édition que beaucoup subissent passivement.
Critique et subjectivité : La question de la sincérité
 Quand on observe les chroniques du critique ivoirien, qui n’ont pas été retouchées – on constate qu’elles finissent pour nombres d’entre elles à se ressembler – il y a cette question de la sincérité de l’auteur qui prédomine et qui m’intéresse. La sincérité est un concept à la fois simple et complexe. Il ne m’est jamais venu à l’esprit d’entrevoir une forme de sincérité dans un projet littéraire, en particulier dans une oeuvre de fiction. Tout n’est que travestissement, simulation et imagination dans un roman. Du moins, je l’entrevois ainsi. La vérité si on doit user de ce terme concerne justement cette forme qui finit par révéler son potier, si le critique prend le temps de le suivre dans la durée, d’observer ses tocs, ses tics, ses obsessions, ses angoisses, ses frayeurs. La sincérité me rappelle la première rencontre. Si la partition jouée est fausse, la tendance est au rejet. Sans juger du travail de mon confrère avec qui je fais de passionnantes émissions, sa virulence prend du coup sens. Nous sommes en format blog, l’auteur pourra réagir à mes mots, mais il me semble que lorsqu’on aborde une oeuvre sous l’angle de la sincérité, la possibilité de toute distance nécessaire explose en vol. La forme devient tout a fait secondaire, aussi exquise soit-elle, aussi porteuse de sens également. Même le fond est discutable. La concaténation des chroniques est de ce point de vue très révélatrice.
Quand on observe les chroniques du critique ivoirien, qui n’ont pas été retouchées – on constate qu’elles finissent pour nombres d’entre elles à se ressembler – il y a cette question de la sincérité de l’auteur qui prédomine et qui m’intéresse. La sincérité est un concept à la fois simple et complexe. Il ne m’est jamais venu à l’esprit d’entrevoir une forme de sincérité dans un projet littéraire, en particulier dans une oeuvre de fiction. Tout n’est que travestissement, simulation et imagination dans un roman. Du moins, je l’entrevois ainsi. La vérité si on doit user de ce terme concerne justement cette forme qui finit par révéler son potier, si le critique prend le temps de le suivre dans la durée, d’observer ses tocs, ses tics, ses obsessions, ses angoisses, ses frayeurs. La sincérité me rappelle la première rencontre. Si la partition jouée est fausse, la tendance est au rejet. Sans juger du travail de mon confrère avec qui je fais de passionnantes émissions, sa virulence prend du coup sens. Nous sommes en format blog, l’auteur pourra réagir à mes mots, mais il me semble que lorsqu’on aborde une oeuvre sous l’angle de la sincérité, la possibilité de toute distance nécessaire explose en vol. La forme devient tout a fait secondaire, aussi exquise soit-elle, aussi porteuse de sens également. Même le fond est discutable. La concaténation des chroniques est de ce point de vue très révélatrice.Un reproche que je pourrais faire aussi à mon collègue Zacharie Acafou, c’est de délaisser, comme il l’a si bien exprimé lors de l’Université Populaire de la littérature Africaine, les instruments de la critique littéraire dont il est pourtant équipé pour ne donner qu’un avis brut dans son blog littéraire sur les oeuvres qu’il apprécie ou pas. Je n’ai naturellement pas à dire comment Acafou doit mener son travail, mais je peux m’exprimer au travers de l’essai qu’il nous propose et observer certains manquements.
Il n’empêche que par son ouverture, la pluralité des réservoirs dans lesquels il tire ses lectures, Zacharie Acafou est le critique africain qui me fait découvrir le plus de nouvelles oeuvres inattendues. Comprenant mieux sa grille de lecture, c’est avec un autre regard que je découvrirais ses chroniques.
(Source : http://gangoueus.blogspot.fr)